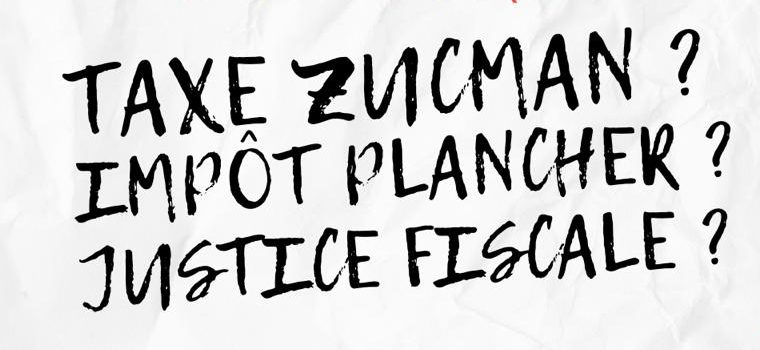Madame/Monsieur la/le Président-e, Monsieur le Rapporteur, Madame la Ministre, Mes chers collègues,
La question qu’on vous pose aujourd’hui est assez simple :
Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel il est autorisé de payer moins d’impôt que le reste de la population ?
L’Institut des politiques publiques a établi dans une étude de 2023 que les plus grandes fortunes paient relativement peu d’impôts sur le revenu en France grâce à l’optimisation légale, lorsqu’on prend en compte l’ensemble du revenu économique.
Et le chiffre est trop parlant pour ne pas réagir : l’ensemble des Français, vous et moi, classe moyenne, classe populaire, comme classe supérieure aisée paie environ 50 % de ses revenus en impôts et cotisations sociales, tous prélèvements compris. À partir de 100 millions de patrimoine, ce chiffre tombe à 27% soit presque deux fois moins.
Ce diagnostic, je crois, n’est pas contesté. En tout cas, madame la Ministre vous ne l’avez pas remis en cause dans nos échanges.
Alors, je repose la question :
Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel il est autorisé de payer moins d’impôt que le reste de la population ?
En France, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine multiplié par 10 en vingt ans, atteignant 1 228 milliards d’euros.
Ce qu’on vous propose n’est pas un impôt confiscatoire ou vexatoire, mais la correction d’une inégalité flagrante. C’est un mécanisme anti-abus. Nous avons besoin de garantir une contribution minimale de tous à l’effort collectif.
Le dispositif est simple : pour les contribuables dont le patrimoine net dépasse 100 millions d’euros, l’impôt total devra atteindre au moins 2% de ce patrimoine. Si ce seuil n’est pas atteint, ils devront verser la différence. Evidemment, et c’est ce qui aujourd’hui fait débat, nous intégrons l’ensemble de la fortune dans ce calcul, sinon on passe à côté du sujet.
On a fait simple mais pas simpliste. Nous avons bien entendu les fatalistes, celles et ceux qui nous disent “vous allez faire fuir les grandes fortunes de notre pays”, celles et ceux qui capitulent devant le chantage à l’exil.
D’abord les études convergent sur le caractère marginal de ce type d’exil. Mais pour répondre aux inquiétudes, un dispositif anti-exil fiscal a été intégré : ceux qui s’expatrient resteront redevables de cet impôt plancher pendant cinq ans.
Ensuite vient le sujet de l’illiquidité, ce patrimoine “valorisé” tant qu’il n’est pas converti en monnaie, et qui serait fragilisé par le besoin de payer cet impôt plancher. Nous proposons donc la possibilité d’étaler les paiements, comme c’est le cas pour l’impôt sur les successions, voire de payer cet impôt en actions.
Reste la question du caractère confiscatoire : pour un impôt plancher de 2% qui concerne un niveau de patrimoine dont le rendement est en moyenne de 5 à 6%, et qui ne s’applique pas en dessous de 100 millions d’euros, disons-le simplement, il ne mettra aucun des contribuables concernés en difficulté et ils pourront continuer à s’enrichir. Un peu moins vite certes.
Alors reposons nous la question :
Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel il est autorisé de payer moins d’impôt que le reste de la population ?
A la veille de débats budgétaires difficiles, si vous n’intégrez pas les plus fortunés dans la communauté nationale, en rattrapant cette injustice fiscale, alors les efforts que vous comptez demander aux françaises et aux français seront inaudibles. Inaudibles.
Rappelons comment Toqueville décrivait l’impôt sous l’Ancien Régime : “Du moment où l’impôt avait pour objet, non d’atteindre les plus capables de le payer, mais les plus incapables de s’en défendre, on devait être amené à cette conséquence monstrueuse de l’épargner au riche et d’en charger le pauvre.”
Dans les cahiers de doléances de 1789, la réforme de l’impôt figure parmi les revendications principales. La nuit du 4 août 1789, c’est la fin des exemptions fiscales de la noblesse et du clergé.
230 ans plus tard, le rétablissement de l’ISF et la soif de justice fiscale irriguent toujours les cahiers de doléances mis en place pendant le mouvement des Gilets Jaunes.
Chers collègues, je l’ai dit il n’y a en réalité qu’une question soulevée par cette proposition : Existe-t-il en France un niveau de richesse à partir duquel on peut s’affranchir de contribuer à l’impôt autant que le reste de la population ?
Évidemment non et nos textes fondateurs sont clairs sur la question : alors respectons l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, faisons en sorte que la contribution commune soit répartie également entre tous les citoyens. Votons ce texte.
Je vous remercie.